Comprendre et utiliser la sociologie du genre
Compte rendu de lecture de : Guillaume Vallet, Sociologie du genre, Thèmes & Débats Sociologie, Bréal, Clamecy, 2018, 176p., 9€.
Par Eric PERERA, janvier 2024
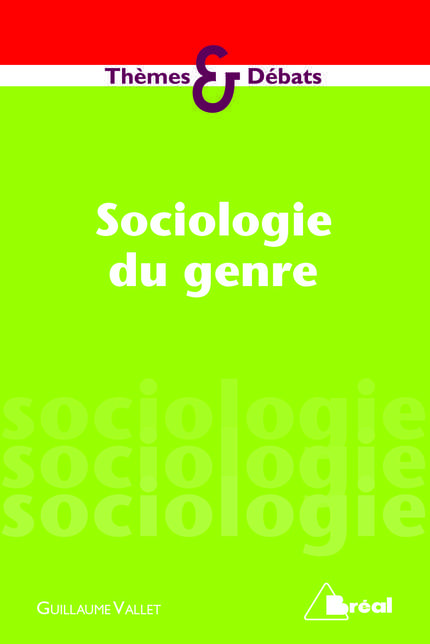
L’ouvrage s’adresse aux étudiant(e)s et apprenti(e)s sociologues mais aussi à celles et ceux en soif de connaissances en sociologie. L’auteur, Guillaume Vallet est Maître de Conférences en Sciences économiques à la Faculté d’Economie de Grenoble. Il se donne pour objectif de montrer comment le concept de genre constitue une grille de lecture heuristique pour aborder tous phénomènes sociaux, anciens comme nouveaux, bien loin des idées reçues naturalisant les différences de comportements entre les femmes et les hommes. L’auteur adopte une posture « critique » vis-à-vis de cette vision binaire et naturalisée produisant des hiérarchies – aux formes discriminatoires – qui s’incarnerait selon lui dans les critiques envers « les prétendues dérives des dites « théories du genre » dans le cadre scolaire » (p. 7) largement médiatisé et certainement opérante. Dans ce sens, les catégories sexuées duales homme/femme forgent des caricatures alors qu’il suffirait de les interroger en système pour comprendre ce qu’elles façonnent socialement. Assurément la lectrice ou le lecteur ne peut alors qu’apprécier la stratégie pédagogique de l’auteur : il se propose de décortiquer les dynamiques du concept de genre pour en présenter ses forces éclairantes des réalités sociales arrêtées, notamment en France contemporaine, en prenant la précaution de préciser qu’il ne s’agit pas ici de faire un inventaire exhaustif des références ou travaux sur le sujet.
S’atteler à présenter une sociologie du genre, la rendre accessible et fonctionnelle, n’est pas une mince affaire, et face à l’ampleur de la tâche, l’auteur étaye tout d’abord l’ouvrage par un état des lieux du concept ou plutôt des concepts de catégorie genre (partie 1), pour ensuite, les éprouver aux réalités du terrain soigneusement thématisées (partie 2) comme l’encourage la collection « Thèmes & Débats Sociologie » (portée par Gilles Renouard) dans laquelle il est publié.
Sa première partie, divisée en 3 chapitres, s’intéresse aux fondements de cette catégorie de genre. Il nous explique que la catégorie sexe est une « case » spontanément utilisée pour penser le social, qui a trouvé du sens en anthropologie pour appréhender les sociétés exotiques. Depuis, les sciences humaines, dont la sociologie, mettent à distance cette simple « case » des différences biologiques en considérant la part sociale du sexe, et lui préfère la notion de genre. Notion qui se focalise aux rôles qu’une société attribue à ce que doit être un homme et une femme, des convenus pour chaque sexe et finalement, des identités dont la socialisation sexuée construit un rapport aux autres et inversement. En ce sens, la part sexuée de l’identité n’est que culturellement construite où l’affichage des différences des sexes ne fait qu’affirmer des logiques genrées intimant inégalités et dominations. Manifestement, l’ancrage biologique sème le « trouble dans le genre », forgeant des représentations sociales et peinant à saisir la diversité des identités de sexe. Plus encore, le genre, développé comme outil d’analyse de la réalité sociale dévoile des normes socialement construites et admises de catégories de sexe qui s’imposent non sans devenir conflictuelles.
Conflits liés à l’ordre biologique et aux classes de sexe, produisant une hiérarchie sociale qui peut s’analyser en système, dont le système patriarcal, où s’exprime une forme de domination masculine. Comprendre « les luttes de classes » de sexe ou ses inégalités, c’est interroger leur construction marquant les rapports de genre et les rapports de pouvoir entre les sexes ; dont l’intérêt sociologique émerge dans les années 50.
Cet éclairage renvoie nécessairement aussi à des questions épistémologiques car la recherche est elle même prise dans ces rapports de genre et le.la chercheur.e produisent de la connaissance selon leur engagement social. Cette focale présente des savoirs situés prenant en compte la subjectivité du chercheur.e qui sont bien plus proche des réalités sociales qu’une posture neutre, posture intenable in situ et trop souvent associée à l’illusion d’objectivité dont les résultats ne seraient que tronqués. Émerge alors, dès les années 80 en France et aux États Unis, un courant appelé gender studies porteur de nouvelles connaissances scientifiques, de formations et de revues spécialisées sur le sujet.
Cet ancrage théorique montre ensuite toute sa portée fonctionnelle lorsque l’auteur aborde « les masculinités » (chapitre 2) et « des femmes en luttes » (chapitre 3), éléments de la première partie. En effet, la domination masculine est pensée comme un système où les hommes asservissent les femmes sur le plan collectif tout en posant historiquement l’hétérosexualité comme norme au centre des relations. Cette supériorité masculine sur le féminin trouvent son inscription dans un déterminisme biologique où l’homme est présenté comme bien plus fort physiquement que la femme[1]. Cette posture asymétrique s’affirme dans les interactions sociales et selon les espaces de sociabilité, elle s’exerce plus ou moins directement rappelant la fragilité supposée des femmes versus la virilité attendue des hommes. Virilité qui s’installe comme un idéal masculin au fil du temps, depuis l’époque hellénistique, forgeant une hiérarchie en faveur des hommes. Si chaque époque semble craindre un renversement – fantasmé ou réel – « d’une effémination ou d’une dévirilisation », les idéaux de la virilité vont se civiliser pour s’exprimer de manière contrôlés et codifiés renforçant les identités de sexe. De la Renaissance jusqu’à la philosophie des lumières, l’accent est mis sur l’infériorité physique et psychologique des femmes, les écartant de l’espace politique malgré les revendications de liberté de la Révolution. Reconnue de tous, la toute puissance de l’homme sur la femme instaure l’ordre des comportements dominant/dominé, fort/faible. Cette différence sera légitimée au XIXème siècle par la science médicale ainsi que le monde du travail où l’ouvrier affirme la masculinité. Pour autant le chambardement de la première guerre mondiale n’ébranle pas l’ordre établi au contraire, « les hommes morts pour la France incarnent les pères symboliques protecteurs des femmes et des faibles » (p. 54). Le masculin se distingue du féminin, renvoyant à des comportements spécifiques – exacerbant l’hétérosexualité – appelés genderism[2] (Goffman, 1977). L’auteur ne manque pas alors de rappeler le caractère pluriel et dynamique de la masculinité et que si la domination de l’homme résiste au fil du temps, elle n’en demeure pas moins également contestée.
Contestations suscitant des doutes et révélant une masculinité qui se veut « défensive ». Face à certains renversements tels que la croyance en la « fin des hommes » ou encore l’importance de plus en plus actuelle d’une identité masculine doublée de qualités (jugées) féminines, les repères traditionnels s’altèrent pour laisser la place à l’incertitude. Incertitude d’autant plus prononcée que nos sociétés individualistes renvoient à la responsabilité de chaque homme à le devenir, non sans affirmation de la position sociale des femmes. Dans ce contexte, tenir une domination masculine et ou crier à la « dévirilisation » relève d’une réaction défensive dont les ressorts s’apparentent au « modèle de l’équité » et au « modèle de l’équivalence » : ces deux modèles se réfèrent aux principes des différences naturelles entre homme et femme, quand le premier prône l’inéquitable en faveur des hommes et le second invoque l’égalité dans les différences qui les séparent par nature. L’identité de sexe masculin s’accroche ici à des modèles « traditionnels » de virilité reconnus jadis, faisant fi des changements collectifs et craignant in fine une égalité aux femmes tenue contre nature.
En sus, cette identité s’accroche à une « masculinité hégémonique » installée dans les rapports sociaux de sexe au profit des hommes dont l’hétérosexualité symbolise la norme – contre la féminité – à maintenir pour dominer. Le système en place est porteur de repères dans la manière de s’opposer d’une catégorie de sexe à l’autre mais aussi de se négocier dans chacune d’elle. Évidemment ces repères sont multiples dans chacune des catégories, avec des modèles dominants qui évoluent selon les époques et leurs contextes socio-culturels. Si la dimension biologique détermine cette opposition entre les catégories de sexe ainsi que sa hiérarchie, elle façonne des comportements spécifiques masculins et féminins qui se transmettent. Et quand des résistances s’expriment pour emprunter aux deux catégories genrées et semer le « trouble », le système sert de précepte et expose à la stigmatisation. L’auteur en déduit le modèle « Hub and Spokes », où le Hub symbolise l’attache à la masculinité hégémonique et les Spokes, les liens plus ou moins proches du monde féminin ; révélateurs d’intersectionnalités possibles. L’influence d’une masculinité hégémonique (ou le Hub) participe aussi aux inégalités hommes et femmes sur le plan démographique. Cette domination masculine acceptée mais aussi intériorisée, semble se généraliser et se renforcer pour « faire le genre » en référence à West & Zimmerman, 1987).
Cette situation n’est pas sans compter sur la lutte des femmes à faire reconnaître ces logiques de genre. Depuis les premières luttes féministes dans les années 1830, ce mouvement social mobilise des femmes comme des hommes pour changer les rapports sociaux de sexe. Si les droits des femmes progressent durant la période 1900-1940, les mouvements féministes des années 1950-1970 prennent une autre dimension à la suite du regard porté par S. De Bouveoir (1949) sur notre société. En dévoilant les mécanismes perpétuant les inégalités de genre, S. De Bouveoir intellectualise alors les rapports de domination en place et légitime le féminisme à renverser cet ordre. Les années 1980 font ensuite émerger un féminisme plus marqué à la fois dans les idées, avec le courant différentialiste qui prône la différence féminine, et dans les manières de lutter, notamment par corps à l’image des Femen. Cependant les années 1990 réinterrogent ce différentialisme à l’instar de J. Butler qui soutient que le sexe n’est qu’une catégorie construite ou encore du « discours » pour désigner les corps, et propose de « repenser les rapports sociaux par la multiplicité ». Les luttes féministes prennent ainsi des formes multiples[3], donnant lieu à différents courants (que l’auteur ne manque pas de présenter) et poussent les femmes à agir – favorisant l’empowerment – et à créer des conditions égalitaires hommes/femmes si celles-ci ne deviennent pas des faux-semblants.
Un indicateur parlant des effets des actions féministes est la réappropriation du corps par les femmes. Le marquage des corps, fait de signes vestimentaires distinctifs pour chaque sexe, a longtemps maintenu les différences de genre (ré)affirmant une domination masculine. Le nudisme montre au contraire des degrés d’ouverture et de liberté qui s’affirment chez les femmes – comme chez les hommes – dans les années 1970 à 1990[4]. Dévoiler le corps est certes une forme de liberté, un enjeu de lutte, mais ça n’épargne pas les femmes du désir d’appropriation des hommes. Plus tard, on assiste à des logiques « pudiques » de mise en scène des corps féminins, que ce soit à la plage ou ailleurs, de nouvelles normes sociales s’installent non sans influence d’une certaine morale religieuse. Ces rapports de pouvoir se jouent également dans d’autres sphères et l’auteur s’attarde particulièrement sur le politique. Si des textes de loi posent le cadre juridique de l’égalité hommes/femmes, notamment après la seconde guerre mondiale, elles ne garantissent pas les mêmes chances d’accès à la réussite. Les politiques publiques y participent en proposant des actions « spécifiques » et ou en adoptant une approche « intégrée » c’est à dire en tenant compte de l’égalité hommes/femmes dans leur gouvernance. Malgré cela les espaces politiques (ou les mouvements associatifs) sont plus ou moins fréquentés par les femmes et de manière très disparate d’un pays à un autre. Les luttes féministes ont ainsi favorisé la participation politique des femmes et ce malgré des discriminations qui persistent encore aujourd’hui en faveur des hommes. Le système en place ne fait que maintenir la « force du genre », une asymétrie induite par différentes sphères.
Trois sphères sont choisies et décortiquées par l’auteur pour former la deuxième partie de l’ouvrage : la sphère domestique (chapitre 4), l’espace scolaire (chapitre 5) et l’univers du sport (chapitre 6). Ces trois entrées constituent manifestement l’intérêt du livre pour saisir de manière originales le caractère opérant de la notion de genre.
Les sphères domestique et professionnelle en font parties et si elles ont certes connu des changements dans le temps, des résistances persistent. Il faut attendre la première révolution industrielle (vers 1830 en France) pour salarier des femmes qui sont plutôt associées au travail domestique et ou à des activités agricoles. L’entrée en masse des femmes sur le marché du travail n’est notable qu’à partir de la fin de la seconde guerre mondiale. On assiste depuis à l’émancipation progressive des femmes, leur offrant une certaine autonomie financière organisant de nouvelles formes de conjugalité où c’est le choix amoureux qui prime et non l’enjeu économique. Cette liberté instaure un autre rapport au mariage, favorisant les divorces et d’autres manières de s’unir (cohabitation, union libre, pacte civil de solidarité, etc.). Le couple prend ainsi une autre dimension loin du modèle familial où la femme avait un rôle passif. Ceci dit, les inégalités ne sont pas pour autant effacées que ce soit dans les tâches domestiques (imputées aux femmes selon une continuité patriarcale et réduisant l’accès à une carrière professionnelle des femmes au profit de celle des hommes), les salaires (des emplois genrés aux effets du « plafond de verre » et au « plancher collant ») ou encore les loisirs.
Cette domination masculine est aussi à l’œuvre dans la sphère scolaire, non sans interrelations fécondes avec les sphères domestiques (socialisation primaire) et professionnelle (choix de filières moins « rentables » et obtention de diplômes pour l’emploi). Ce n’est que depuis les années 1880 que les filles ont accès à l’école même si les enseignements les forment à devenir de « bonnes épouses et mères ». Après la massification scolaire des années 1950, la séparation entre les sexes demeure. On assiste par exemple, au niveau du baccalauréat et ensuite à l’université à des inégalités statistiques dans le choix des filières. Ceci est sans compter le contenu des manuels scolaires qui valorisent une domination masculine face à des enseignant(e)s peu enclin à « casser le genre » faute de formations sur le sujet. Cependant, ces effets de genre scientifiquement mis à jour, les ministres de l’Éducation Nationale ont pris des mesures ces dernières années pour lutter contre les inégalités hommes/femmes. Malgré une volonté de neutralité dans la mixité, les identités de sexe se façonnent dans la sphère scolaire comme dans la sphère familiale qui tendent à « rassembler et séparer », pour finalement socialiser à ce qu’est une fille et un garçon voir de renforcer ces stéréotypes.
Des stéréotypes qui s’expriment aussi bien dans la sphère sportive. Dès l’apparition des sports modernes durant la seconde partie du XIXème siècle, la femme en est exclue, assignée à des activités qui préservent leur « nature » destinée à la maternité et aux tâches domestiques. Quand le sport consacre le muscle et met en scène la virilité, associés à l’homme. Ce qui n’empêche pas les femmes d’y trouver un espace d’expression, d’affirmer une excellence féminine et de malmener les représentations de genre associées au corps. Seulement, les inégalités subsistent – notamment sur le plan médiatique et économique – puisque la performance en tant qu’enjeu du sport est associée par nature à la masculinité. D’un côté le sport valorise et affirme une masculinité hégémonique avec ces attitudes spécifiques et de l’autre, il condamne ce qui s’en éloigne et ce qui se rapproche du féminin comme l’homosexualité. Le corps sportif est par exemple un révélateur de cette expression de la masculinité. En se conformant aux normes viriles, il devient un moyen de « faire le genre » et d’affirmer la catégorie de sexe des hommes. Rendre son corps remarquable consiste alors à s’approprier les signes extérieurs d’une masculinité hégémonique dont le corps sportif ou encore body-buildé sont des modèles pour plaire, se plaire et se distinguer des autres. Les athlètes femmes sont quant à elles réduites à arborer des signes féminins au risque d’être discrédités malgré leurs performances. Dans ce sens, l’exemple des femmes body-buildés qui semblent bousculer les genres depuis son apparition dans les année 1970, est parlant : ces dernières valorisent non seulement les body-builders par leur moindre développement musculaire mais elles laissent progressivement la place aux femmes qui pratiquent du body-fitness au corps jugé plus féminin et donc plus acceptable. Ces logiques d’expression du genre sont particulièrement visibles dans l’univers du sport parce qu’elles sont cristallisées dans le rapport au corps d’une masculinité hégémonique.
Finalement, cet ouvrage nous présente des clés pour saisir certaines réalités sociales à partir de la grille de lecture du genre. Les différents chapitres de la deuxième partie nous proposent ensuite des exemples opérants, des entrées réflexives qui posent un regard socio-historique d’une compréhension des mécanismes qui consistent à faire et ou à défaire le genre. L’intérêt de l’ouvrage réside dans le choix des thèmes abordés, de la sphère domestique à celle de l’école jusqu’au sport. Cette approche se veut heuristique dans la mise en évidence de processus de contrôle et de résistance pour l’égalité des hommes et des femmes dans nos sociétés contemporaines aux valeurs androcentriques.
Cet ancrage de la notion de genre à travers des univers parlant aujourd’hui, demande tout de même à être complété et discuté par de la littérature absente dans l’ouvrage. Comme évoqué plus haut – en notes de bas de page – il serait nécessaire d’intégrer certains travaux de la sociologie du genre et plus encore, lorsque l’auteur aborde la sphère sportive tels que les travaux de Louveau & Métoudi (1986), Louveau (2002, 2004), Mennesson (2005), Guerandel (2016) ou encore plus récemment ceux de Froidevaux (2019, 2020, 2022). Ces références discutent le rapport à la performance sportive des femmes et les effets silencieux des normes sociales.
Il s’agit alors d’être attentif aux résistances, à ce qui sème le « trouble » – objet de recherche en sociologie – pour non seulement renforcer et valoriser d’autres manières d’exprimer les catégories de genre mais aussi pour « défaire » toutes tentatives de réduction genrée. On peut tout de même se demander dans quel mesure ces tentatives de réduction genrées, de plus en plus ciblées par des dispositifs de signalement ces dernières années, tendent à « crisper » les rapports de genre plutôt que de les « défaire » .
Bibliographie
Clair I . (2012) ; Sociologie du genre, Paris, Armand Collin, coll. « 128 », 125 p.
Détrez C. (2002). La construction sociale du corps. Paris, Seuil.
Fournier M. (2014). Masculin-Féminin. Pluriel. Essais, Ed. Sciences humaines, 264 p.
Guionnet C. & Neveu E. (2004), Féminin/Masculin. Sociologie du genre, Paris, Armand Colin.
Froideveaux-Mettrie C. (2015), La révolution du féminin. Gallimard, Paris, 370 p.
Froideveaux S. (2019), Des armes, du sport, des hommes… et des femmes. Genre et techniques dans le tir sportif en Suisse. Artefact, 9, 175-195.
Froideveaux S. (2020), Des corps et des armes : Devenir un sujet genré par la pratique sportive du tir à l’arc et du tir à l’arme à feu en Suisse, Thèse, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne.
Froideveaux S. (2022), La production de la « différence sexuelle » des corps dans la pratique sportive du tir à l’arc, SociologieS, 1-7.
Guerandel C. (2016). Le sport fait mâle. La fabrique des filles et des garçons dans les cités. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 230 p.
Kaufmann, J. (1995). Corps de femmes, regards d’hommes : sociologie des seins nus. Paris : Nathan, « essai & recherches ».
Louveau C. & Metoudi M. (1986). Talons aiguilles et crampons alu… Les femmes dans les sports de tradition masculine. [Rapport de recherche] Institut National du Sport et de l’Education Physique (INSEP).
Louveau C. (2002). Les femmes dans le sport : construction sociale de la féminité et division du travail. Cahiers de l’INSEP, 32-1, 49-78.
Louveau C. (2004). Sexuation du travail sportif et construction sociale de la féminité, Association féminin masculain recherchers, « cahiers du Genre, 1, 36, 163-183.
Mennesson C. (2005). Être une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et construction du genre, Paris, L’Harmattan, 365 p.
Perera E. & Soldani J. (2021) Les nudités récréatives. Revue Nature & Récréation, n°11. https://fr.calameo.com/books/00485275747fb798179eb
West C. & Zimmerman, D.H. (1987). « Doing gender ». D.H. (1987). « Doing gender ». Gender and society, 1, pp. 125-1
[1] Pour comprendre ce rapport de domination de l’homme sur la femme, François Héritier parle de la « valence différentielle des sexes ». Selon l’auteur, « ce rapport émanerait de la volonté de contrôle de la reproduction de la part des hommes, qui ne peuvent pas faire eux-mêmes leurs fils. Les hommes se sont appropriés et ont réparti les femmes entre eux en disposant de leur corps et en les astreignant à la fonction reproductrice » (interview de Mulot M., 2009, Françoise Héritier : « Les hommes et les femmes seront égaux un jour, peut-être… », Sciences et Avenir).
[2] En français « parades sexuées ».
[3] Pour en savoir davantage sur les mouvements féministes, d’autres lectures sont nécessaires comme entre autres Guionnet C. & Neveu E. (2004), Clair (2012), Fournier (2014), Froideveaux-Mettrie (2015), etc.
[4] Rappelons tout de même que ce n’est pas n’importe quel corps qui est montré : plus le corps se dénude plus il répond aux normes esthétiques dominantes avec ces formes d’autocontraintes pour correspondre à ces normes (Kauffman, 1995 ; Détrez, 2002 ; Perera & Soldani, 2021).