L’adaptation de la station de Chamrousse face au changement climatique
La question du changement climatique est devenue une préoccupation croissante à l’échelle mondiale. Aucun territoire n’est désormais épargné et les stations de montagne ne font pas exception, subissant de plein fouet les effets d’une saison hivernale raccourcie due à un manque d’enneigement provoqué par l’élévation des températures. Cet enjeu est d’autant plus crucial pour les stations de basse et moyenne altitude, qui se trouvent confrontées au dilemme de repenser leurs activités en adoptant de nouvelles stratégies ou de consolider celles déjà existantes, souvent centrées sur la pratique du ski. Cependant, ces stations sont confrontées à une réalité complexe : elles ne peuvent pas arbitrairement choisir une stratégie d’adaptation sans prendre en compte une multitude de variables. À travers des entretiens semi-directifs menés auprès de trois acteurs de la station de Chamrousse et un maître de conférences, nous démontrons que les caractéristiques territoriales, la gouvernance et les dynamiques de pouvoir exercent une influence déterminante sur le choix des stratégies d’adaptation face au changement climatique.

Par Thibault Fernandes
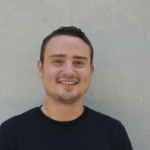
Avant de m’installer à Montpellier pour mes études, j’ai résidé pendant de nombreuses années en Isère, à proximité d’un massif montagneux. Passionné par le ski, cette activité a rythmé mon quotidien. Naturellement, j’ai choisi d’explorer un sujet d’actualité centré sur l’environnement montagnard, plus particulièrement sur les stations de ski.
introduction
Le changement climatique représente une réalité incontestable qui exerce une pression considérable sur les stations de montagne. Des phénomènes tels que la fonte des glaciers, la diminution de l’enneigement et l’augmentation des événements climatiques extrêmes obligent les acteurs de la montagne à déployer des solutions ingénieuses pour s’adapter à ces nouvelles conditions. Selon une étude menée par Solelhac et Hautbois (2021), les Alpes ont enregistré une augmentation de température de 2 degrés, comparativement à 0,89 degré enregistré dans les zones de plaine, sur la période allant de 1880 à 2012. Cette hausse des températures s’accompagne également d’un déplacement de la limite pluie-neige vers des altitudes plus élevées, avec une élévation d’environ 300 mètres depuis 1960, affectant principalement les stations de basse ou moyenne altitude (Clivaz et al., 2015). La station de ski alpine de Chamrousse n’échappe pas à ce phénomène. Une étude de l’Observatoire national de la montagne réalisée en 2020 a révélé une tendance alarmante : le nombre de jours de neige par an diminue continuellement depuis quelques décennies. Par conséquent, la durée de la saison de ski a été réduite, passant d’une moyenne de 138 jours dans les années 1960-70 à seulement 115 jours dans les années 2010.
L’adaptation des stations de ski au changement climatique représente un enjeu crucial inscrit dans une perspective de développement durable (Bailly, 2002). Cependant, assurer un avenir viable pour les stations de montagne devient de plus en plus problématique, car le réchauffement climatique constitue un défi majeur pour des destinations qui reposent essentiellement sur le tourisme hivernal et un modèle économique largement dépendant de l’enneigement (Marty et al., 2017). La diminution de la saison de ski, ainsi que l’incertitude et la qualité de l’enneigement, menacent gravement l’activité économique de ces stations (Bessy, 2021). Les touristes sont réticents à réserver des vacances à la neige lorsque les conditions d’enneigement ne sont pas garanties. Cette situation peut entraîner des conséquences désastreuses sur la pérennité des stations de montagne.
Dans ce contexte, il est indispensable que la question de l’adaptation au changement climatique soit présente dans l’ensemble des stratégies de développement des stations de montagne. Contrairement à l’approche comparative adoptée par Buin (2022), notre étude se concentre spécifiquement sur l’analyse approfondie du cas de Chamrousse. Nous verrons donc uniquement le fonctionnement de la station alpine de Chamrousse, répartie sur plusieurs niveaux : Chamrousse 1600, Chamrousse 1650, Chamrousse 1700, Chamrousse 1750 et Chamrousse 2250 étant son point culminant. Par ses différents niveaux, la station alpine est perçue comme une station de moyenne montagne, à la limite de la haute montagne. Chamrousse se situe sur le massif de Belledonne et est distante d’environ 30 kilomètres de Grenoble. Elle est également l’une des plus fréquentées du département Isérois, s’expliquant par la taille de son domaine offrant de nombreuses possibilités pour les visiteurs avec plus de 90 kilomètres de pistes de ski alpin et 40 kilomètres de pistes de ski nordique[1]. Par ailleurs, Chamrousse n’est pas seulement une station de montagne, mais également une ville disposant d’une mairie et d’infrastructures scolaires. Par conséquent, Chamrousse est composée de plusieurs acteurs jouant un rôle dans le fonctionnement de la station et de la ville.
Les différentes stratégies d’adaptation
Les stations de montagne ont élaboré au fil du temps une variété de stratégies d’adaptation distinctes (Solelhac et Hautbois, 2021). Cette diversité reflète les particularités de chaque station, influencées à la fois par leur emplacement géographique et les activités qu’elles offrent. Trois stratégies principales d’adaptation émergent ainsi de ces observations (ibid.) :
La première stratégie, appelée « ajustement », se concentre sur la priorisation de la saison hivernale, malgré les menaces posées par le changement climatique. Cette approche est souvent caractérisée par l’utilisation de canons à neige le long des pistes pour pallier le manque de neige lorsque nécessaire. Comme l’évoquent Bonnemains, Clivaz et Franco (2022), ces stations de montagne adoptent des facteurs de rigidité et dépendent presque entièrement du modèle des sports d’hiver. Dans certains cas, cette stratégie peut être étendue à la saison estivale, comme l’a fait la station de Morzine avec le développement du VTT (vélo tout terrain).
La deuxième stratégie, qualifiée de « transformationnelle », vise à renforcer l’attrait de la station en proposant des activités complémentaires à la pratique du ski. Cette approche se traduit généralement par une diversification de l’offre tout au long de l’année, avec des activités telles que le VTT, le parapente, la via ferrata, la luge, la plongée sous glace, et bien d’autres. Selon George, Achin, François, Spandre et al (2019), la mise en place de cette stratégie doit être réalisée en fonction des ressources disponibles de chaque territoire.
Enfin, la dernière stratégie adoptée est celle de « l’atténuation », visant à réduire l’impact négatif de chaque action sur le climat. Cette approche englobe la prise de décisions énergétiques réfléchies, l’adoption de modes de transport durables, ainsi que la mise en œuvre de programmes de collecte des déchets et de tri sélectif.
Il est important de noter qu’une station peut mettre en œuvre plusieurs de ces stratégies simultanément. C’est pourquoi, selon Vlés (2021), il est important d’avoir des études prévisionnelles pour les stations de montagne afin qu’elles puissent adapter leurs stratégies en fonction de leurs caractéristiques territoriales.
L’influence des caractéristiques territoriales sur le choix des stratégies d’adaptation
Selon Charrier et Jourdan (2019), les dynamiques locales englobent l’ensemble des interactions, des acteurs et des processus qui se déploient à l’échelle d’un territoire spécifique. L’approche par les dynamiques locales vise à comprendre comment ces éléments interagissent et influencent les comportements et les décisions des acteurs dans un contexte territorial donné. Adopter cette approche nous permet de connaître précisément chaque caractéristique du territoire de Chamrousse.
La caractérisation géographique et environnementale constitue l’une des clés pour appréhender les dynamiques locales. En effet, la prise en compte de ces spécificités géographiques et spatiales joue un rôle crucial dans l’analyse (Augustin, 2008). La géographie facilite également l’étude des dynamiques de développement local, des stratégies des acteurs, des conflits d’usage du territoire et des politiques d’aménagement. Dans le cadre de notre recherche, cela nous permettra de saisir les différentes caractéristiques géographiques de Chamrousse ainsi que leur influence sur le choix des stratégies d’adaptation.
De manière similaire, les caractéristiques économiques représentent une autre dimension essentielle à prendre en compte dans l’étude des dynamiques locales (Courlet, 2008). Comprendre les flux économiques, les sources de revenus, ainsi que les modèles économiques prévalant à Chamrousse nous permettront de mieux cerner les défis et les opportunités pour le développement durable de la station.
En outre, les aspects sociaux jouent un rôle crucial dans la compréhension des dynamiques locales (Di Méo, 2008). Les structures sociales, les dynamiques démographiques, ainsi que les valeurs et les pratiques culturelles propres à la communauté de Chamrousse influencent potentiellement les choix et les comportements des acteurs locaux.
La gouvernance : Une multiplicité d’interactions complexes
Pour une meilleure compréhension de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation, nous devons explorer également le rôle de la gouvernance et les relations entre les acteurs impliqués. Dans le cas spécifique de la station de Chamrousse, l’application de la théorie de l’acteur et du système, développée par Crozier et Friedberg (1993), nous conduit à analyser les dynamiques de pouvoir entre les parties prenantes impliquées dans la gestion et l’adaptation de la station. Chaque acteur détient des ressources spécifiques telles que des compétences, des financements et des réseaux, qu’il peut mobiliser pour atteindre ses objectifs. De plus, les acteurs ont leurs propres représentations et perspectives sur la manière dont la station devrait être gérée et adaptée en fonction de leurs intérêts particuliers. Ces divergences d’intérêts et de représentations peuvent engendrer des conflits ainsi que des négociations entre les acteurs, influençant ainsi la stratégie d’adaptation mise en œuvre (Lascoumes et Le Galès, 2014).
Dans le contexte de la station de Chamrousse, la multitude de relations de pouvoir et de dynamiques entre les acteurs est-elle essentielle pour élaborer et déployer efficacement une stratégie d’adaptation ? La capacité des acteurs à mobiliser leurs ressources, à défendre leurs perspectives tout en négociant leurs intérêts, influence-elle de manière déterminante la formulation et la mise en œuvre de ces stratégies ?
Ainsi, dans cet article la problématique centrale est la suivante : « Quels sont les facteurs qui influent sur les choix d’adaptation de cette station face au changement climatique ? »
Nous nous efforcerons de comprendre les différentes stratégies mises en œuvre par la station de Chamrousse, l’impact des caractéristiques territoriales sur ces choix, et d’évaluer le rôle de la gouvernance en tant que facilitateur ou obstacle à ces processus d’adaptation.
Méthodologie
Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’utiliser des entretiens semi-directifs pour recueillir des données qualitatives. Cette méthodologie permet à la fois de guider le déroulement des questions tout en laissant une certaine liberté à l’interlocuteur pour s’exprimer sur le sujet (Baribeau et Royer, 2012).
Les entretiens ont été construits à partir d’une grille d’entretien, un outil essentiel pour obtenir des entretiens de qualité.
La grille d’entretien a été structurée en quatre thèmes principaux :
– Thème 1 : Questions personnelles visant à mettre à l’aise l’interlocuteur et à établir un climat de confiance pour la suite de l’entretien.
– Thème 2 : Les mesures mises en place par la station pour s’adapter au changement climatique, afin de comprendre les stratégies choisies.
– Thème 3 : Les caractéristiques du territoire de Chamrousse, pour identifier celles qui ont le plus d’influence dans le choix des stratégies.
– Thème 4 : La gouvernance et les relations de pouvoir au sein de la station, afin d’évaluer leur rôle en tant que facilitateur ou obstacle dans la mise en place des stratégies.
En plus de la grille d’entretien, nous devons définir un échantillon pour réaliser les entretiens semi-directifs. Dans notre étude, l’échantillon a été choisi de manière logique et ciblée vers les différents acteurs de la station de Chamrousse, tels que la mairie, l’office du tourisme, la régie des remontées mécaniques, la communauté de communes, les entreprises privées et les associations. Ces entités sont les mieux placées pour fournir des éléments de réponse à notre problématique, étant donné qu’elles font partie intégrante du paysage de Chamrousse. Nous restons ouverts à l’idée d’élargir notre échantillon à des personnes extérieures au fonctionnement de la station, dans la mesure où elles peuvent nous fournir des données concrètes et pertinentes.
Nous avons réalisé des entretiens avec le directeur de l’Office de tourisme, le responsable des pistes de la station de Chamrousse et la chargée de projet transition des stations de montagne à la communauté de communes du Grésivaudan, ainsi qu’un enseignant du master 2 stratégies économiques du sport et du tourisme à Grenoble, dont le sujet de travail était la station de Chamrousse. Les entretiens ont été menés en personne avec le directeur de l’Office de tourisme et en distanciel pour le reste, et ont duré environ 1 heure.
| Directeur de l’Office de Tourisme | Intervenant extérieur (Enseignant et Maître de conférences) | Responsable des pistes | Chargée de projet transition des stations de montagne | |
| Durée | 50 minutes | 52 minutes | 1h20 | 52 minutes |
| Conditions | En présentiel à l’Office de tourisme de Chamrousse | En distanciel sous forme de visioconférence | En distanciel sous forme de visioconférence | En distanciel sous forme de visioconférence |
| Fonctions occupées | Directeur de l’Office de tourisme de Chamrousse | Maître de conférences en Management du Sport et Développement Territorial à l’Université Paul Sabatier Toulouse 3. Mais aussi enseignant en Master 2 à Grenoble | Responsable des pistes de l’ensemble de la station de Chamrousse | Chargée de projet transition des stations de montagne à la communauté de commune du Grésivaudan |
Figure 1 : Tableau récapitulatifs des entretiens
Une variété de stratégie pour s’adapter au réchauffement climatique
Face aux impacts du réchauffement climatique, la station de Chamrousse a mis en place trois stratégies distinctes mais complémentaires, telles que décrites dans les travaux de Solelhac et Hautbois (2021).
La station de Chamrousse est consciente des effets du réchauffement climatique mais elle a choisi d’adopter une stratégie « d’ajustement » visant à prolonger au maximum la saison hivernale, car le ski demeure l’activité principale : « les moyennes et grandes stations ont basé leur modèle sur le ski » (Intervenant extérieur). Pour garantir la saison de ski, Chamrousse utilise depuis quelques années de l’enneigement artificiel grâce à ses canons à neige et ses retenues collinaires, ce qui permet selon le responsable des pistes : « de sécuriser en moyenne 50% du manteau neigeux sur l’ensemble du domaine skiable ». L’année dernière, grâce à cette stratégie, le domaine skiable de Chamrousse a été l’un des trois seuls en Isère à rester ouvert durant toute la saison.
Tout de même, la station de Chamrousse reconnaît qu’elle ne pourra pas continuer à baser son activité exclusivement sur le ski, car les conditions climatiques futures ne le permettront pas. C’est pourquoi elle a aussi adopté une stratégie « transformationnelle », visant à diversifier son offre touristique. Cette diversification passe par le développement de nouvelles activités et infrastructures, telles que la passerelle himalayenne, les belvédères et la plus grande tyrolienne du monde, inaugurée le 17 juin 2023. L’objectif est de proposer des activités variées pour tous types de clientèle, au-delà du seul ski. Dans cette optique, Chamrousse cherche à mettre en place des équipements réversibles, comme les remontées mécaniques et la tyrolienne, utilisables toute l’année. En adoptant ce modèle, la station de Chamrousse ne se définit plus uniquement comme une station de ski, mais comme une destination proposant une multitude d’activités : « aujourd’hui, on ne peut plus parler de station de ski, car la saison estivale et les ailes de saison sont toutes aussi importantes » (chargée de projet transition des stations de montagne).
La dernière stratégie adoptée par Chamrousse est celle de « l’atténuation », visant à réduire l’impact de ses activités sur le climat afin de freiner le réchauffement climatique. Pour atteindre cet objectif, la station a mis en place de nombreuses actions sur son territoire, telles que la gestion des déchets avec des poubelles de tri, des bacs de compostage, la récupération de matériel de ski et des opérations de ramassage. Chamrousse a également adopté l’éclairage LED (Light Emitting Diode) pour réduire sa consommation d’électricité et améliorer sa propreté énergétique. Dans cette même optique de propreté énergétique, les remontées mécaniques adaptent leur vitesse en fonction de la fréquentation, et la gestion du damage a été repensée : « nous sommes passés au HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un carburant d’origine végétale dont la fabrication émet 83 % de gaz à effet de serre en moins » (responsable des pistes). Chamrousse œuvre également à la préservation et à la protection des espaces naturels sensibles (ENS) ainsi que des zones Natura 2000 présentes sur son territoire. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans la charte du label Flocon Vert et du Pacte Mondial de l’ONU (Organisation des Nations unies), que la station a rejoint ces trois dernières années afin d’améliorer son développement durable.
Les trois caractéristiques influencant le choix des stratégies : géographique, sociale et économique
Les trois stratégies mises en place par la station de Chamrousse ont été soigneusement choisies en se basant sur le modèle de Charrier et Jourdan (2019), qui souligne l’importance de bien comprendre ses caractéristiques territoriales.
Les caractéristiques géographiques et environnementales influencent fortement les choix stratégiques de la station de Chamrousse. En raison de sa position à la limite entre la moyenne et la haute montagne, avec un point culminant à seulement 2250 mètres, Chamrousse ne bénéficie pas de toutes les conditions optimales pour une station de ski. L’enneigement de Chamrousse est particulier : il est comparable à celui des Alpes du Nord, mais la fonte des neiges est similaire à celle des Alpes du Sud ou des Alpes-de-Haute-Provence. De plus, ces dernières années, l’enneigement est devenu de plus en plus irrégulier, obligeant parfois la station à proposer des activités estivales telles que le quad pour remplacer la motoneige en hiver.
Face à cette situation, les responsables de Chamrousse comprennent la nécessité d’adapter leur mode de fonctionnement : « Cela fait partie du plan de voir la montagne autrement » (directeur de l’Office de tourisme). Pour mieux connaître ses caractéristiques géographiques et environnementales, la station a décidé de suivre le concept de Vlés (2021) en réalisant plusieurs études diagnostiques. La station dispose d’une maison de l’environnement dédiée à l’étude et à la préservation de la faune, de la flore et de la géologie locales. Chamrousse a également sollicité Météo-France et l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) pour mener des études en vue d’obtenir des subventions pour la neige de production.
L’étude la plus importante réalisée sur le territoire est celle de ClimSnow[2], effectuée sur la saison 2021-2022, qui prévoit l’enneigement jusqu’en 2050-2100 selon différents scénarios. En partie grâce à ces prévisions, la station n’a pas complètement abandonné les activités de ski et la saison hivernale, certains scénarios optimistes indiquant que Chamrousse pourrait encore bénéficier d’une trentaine d’années de saisons hivernales : « Selon les études de ClimSnow, avec des modifications du climat, nous avons encore jusqu’à 2050, soit vraiment encore 30 années » (responsable des pistes).
Certaines activités de la station ne sont pas uniquement influencées par les caractéristiques météorologiques, mais aussi par la beauté des paysages et l’histoire du territoire. Les passerelles himalayennes et la tyrolienne offrent une vue à 360° sur le bassin grenoblois, les chaînes de montagnes voisines comme la Chartreuse, l’Oisans, le Vercors et par ailleurs permettent de survoler le mythique couloir de Casserousse, site des épreuves de ski des Jeux olympiques de 1968.
D’après les travaux de Di Méo (2008), il est crucial de comprendre le rôle des aspects sociaux dans l’influence sur le choix des stratégies. Grâce à son emplacement, Chamrousse est l’une des rares stations situées à proximité d’une agglomération de l’envergure de Grenoble, permettant un accès rapide en seulement 20 à 30 minutes. Cette proximité explique pourquoi 70 % de la clientèle de Chamrousse est constituée de la population locale, tandis que les séjours représentent les 30 % restants.
Le segment de clientèle de la station est principalement familial. Cependant, le projet de rénovation et d’aménagement « Chamrousse 2030 » a été mis en pause, car les études ont montré qu’il ne correspondait pas aux attentes de la clientèle ciblée par la station. Par ailleurs, la population locale ne se rend plus à Chamrousse uniquement pour skier toute la journée. Comme l’a noté un intervenant extérieur : « Si tu regardes toutes les études, les plus mordus de ski, c’est les plus de 50 ans. Donc une clientèle qui a tendance à diminuer mécaniquement ». Le directeur de l’Office de tourisme ajoute : « Les gens ne viennent plus pour skier de 8h00 jusqu’à la fermeture des pistes. Ils viennent pour faire 2 heures de ski, 2 heures d’autres activités et profiter de la nature et de la montagne ».
Depuis la crise du Covid-19, les habitudes et modes de vie ont évolué rapidement, car la population n’a pas apprécié les confinements. En conséquence, Chamrousse a vu un grand nombre d’excursionnistes affluer sur son territoire pour profiter de la nature. Cela a conduit à une surfréquentation de certains sites, comme le lac Achard, et à des comportements nuisibles pour l’environnement : « Il y a beaucoup de gens qui viennent bivouaquer parce que c’est un site extrêmement accessible, qui se baignent dans le lac, perturbant ainsi les milieux, ou qui permettent à leurs animaux, en général des chiens, de se baigner, ce qui est catastrophique pour l’écosystème. Des personnes montent avec des mini-haches pour couper des arbres, et au fil du temps, cette zone s’est déboisée de plus en plus en raison des feux de camp, alors que les feux sont interdits » (chargée de projet transition des stations de montagne).
Face à ces défis, Chamrousse a intégré une stratégie « d’atténuation » en choisissant de ne plus promouvoir le lac Achard et en installant des éco-compteurs pour mieux comprendre la fréquentation des différents sites de son territoire.
En se basant sur les travaux de Courlet (2008), la caractéristique économique est la dernière ayant un impact significatif sur le choix des stratégies. Chamrousse réalise presque l’entièreté de son chiffre d’affaires durant la saison hivernale avec 90 % des revenus générés pendant cette période et seulement 10 % durant la saison estivale. De plus, ces revenus proviennent principalement de l’activité phare, le ski, car il est impossible de compenser avec d’autres activités : « S’il n’y a pas de ski, ce n’est pas en vendant 10-15 tours de luge que nous serons rentables » (responsable des pistes).
Bien que la saison hivernale soit de loin la plus rentable, la station de Chamrousse s’efforce de diversifier ses activités tout au long de l’année pour obtenir un complément financier. Cependant, l’augmentation du coût de l’électricité a entraîné une crise énergétique qui a posé de nombreux problèmes aux stations de montagne, y compris Chamrousse : « En novembre 2022, le prix de l’électricité a été multiplié par 20, ce qui constitue un véritable problème » (directeur de l’Office de tourisme). En réponse, la station a rapidement adapté ses méthodes de fonctionnement pour les remontées mécaniques, le damage et l’éclairage.
Une gouvernance jouant un rôle de facilitateur dans les prises de décisions
En s’appuyant sur la théorie de l’acteur et du système de Crozier et Friedberg (1993) et l’analyse des dynamiques de pouvoir d’un territoire, on constate que la gouvernance de la station de Chamrousse est moins complexe que celle d’autres stations de montagne.
Chamrousse est structurée autour de trois entités principales : la mairie, l’Office du tourisme et la Régie des remontées mécaniques. La mairie prend toutes les décisions concernant la station et la ville, l’Office du tourisme gère l’image de la station, l’accueil, l’événementiel et la clientèle, tandis que la Régie des remontées mécaniques est responsable du domaine skiable et des installations mécaniques. Une particularité notable de la Régie est qu’elle a été reprise par la mairie pour un euro symbolique après la faillite de la compagnie Transmontagne en 2007, ce qui en fait un acteur clé dans le financement des infrastructures de la station. En tant que régie à autonomie financière, les bénéfices réalisés sont réinvestis pour améliorer les équipements.
Ces trois entités collaborent étroitement, facilitant les échanges et la mise en œuvre de nouveaux projets : « La chance qu’on a, c’est qu’on s’entend quand même assez bien les 3 entités, les remontées mécaniques, la mairie et l’Office de tourisme, ce qui n’est pas le cas de toutes les stations, ça nous permet quand même d’être en harmonie aussi pour recevoir de nouveaux projets pour ouvrir le territoire » (directeur de l’Office de tourisme). Cette coopération top-down fonctionne sans friction notable entre les entités principales. De plus, une quatrième entité, composée des habitants, restaurateurs, hébergeurs, école de ski, et prestataires, est de plus en plus impliquée dans les projets de la station : « Des réunions sont faites, maintenant le maître mot, c’est ça, il faut de la concertation » (responsable des pistes).
Pour financer ses projets, Chamrousse ne peut compter uniquement sur ses bénéfices annuels et doit solliciter des subventions à divers niveaux administratifs : l’État, la région, le département, la métropole et la communauté de communes du Grésivaudan. Ces subventions sont attribuées en fonction des secteurs d’intervention, comme l’enneigement. Pour obtenir ces financements, Chamrousse doit réaliser des études et élaborer un schéma directeur avec une vision à long terme de ses investissements et de leur impact écologique. Il est à noter que les fonds publics ne doivent pas dépasser 80% du financement d’un projet, les 20% restants devant être des fonds privés, une contrainte que Chamrousse peut respecter grâce à son autonomie financière.
Le lien le plus fort avec une entité extérieure est celui avec la communauté de communes du Grésivaudan, qui se situe sur le territoire de la station. Bien que cette communauté ne fasse pas partie des organes décisionnels de Chamrousse, elle est consultée pour les nouveaux projets. Les deux entités collaborent sur des projets touristiques diversifiés, même si des différences d’intérêts peuvent parfois freiner certains projets, comme l’évoquent Lascoumes et Le Galès (2014) dans leurs travaux sur les divergences et relations de pouvoir entraînant conflit et négociation. Malgré cela, les deux parties cherchent à renforcer leur collaboration : « En fait, nous, quand on échange avec Chamrousse, avec l’Office de tourisme et cetera. On est globalement assez d’accord qu’il faudrait qu’on apprenne à travailler davantage ensemble. Donc il n’y a pas de mésentente, mais il y a un manque de lien parfois sur ces projets-là, ressenti dans un sens comme dans l’autre, et je pense qu’on gagnerait, et on en est tous d’accord, à travailler davantage ensemble » (chargée de projet transition des stations de montagne).
Conclusion
La station de Chamrousse a adopté une approche globale et proactive face aux défis du réchauffement climatique en mettant en place trois stratégies principales : ajustement, transformation et atténuation.
La stratégie « d’ajustement » vise à prolonger la saison hivernale grâce à l’enneigement artificiel, ce qui a permis à Chamrousse de rester ouverte durant toute la saison malgré des conditions climatiques défavorables. Cependant, consciente que le ski ne pourra pas toujours être l’activité principale en raison du réchauffement climatiques, Chamrousse a développé une stratégie « transformationnelle ». Celle-ci consiste à diversifier son offre touristique avec des activités attractives toute l’année, comme des passerelles himalayennes, des belvédères et une tyrolienne géante, transformant ainsi la station en une destination multi-activités. La stratégie « d’atténuation » se concentre sur la réduction de l’impact environnemental des activités de la station. Des mesures telles que la gestion des déchets, l’utilisation d’énergies renouvelables, et la protection des espaces naturels sont mises en place. Ces initiatives sont alignées avec des engagements internationaux pour le développement durable.
Les choix stratégiques de Chamrousse sont influencés par des caractéristiques géographiques, sociales et économiques. La station tire parti de sa position géographique particulière et de sa proximité avec Grenoble pour attirer une clientèle locale, tout en adaptant ses offres aux changements climatiques et aux attentes évolutives des visiteurs. Économiquement, bien que la saison hivernale reste la plus rentable, la diversification des activités est essentielle pour assurer une viabilité financière toute l’année.
La gouvernance de Chamrousse facilite la mise en œuvre de ces stratégies grâce à une collaboration étroite entre la mairie, l’Office du tourisme et la Régie des remontées mécaniques. Cette coopération est renforcée par une concertation régulière avec les acteurs locaux et la recherche de subventions pour financer les projets. La communauté de communes du Grésivaudan joue également un rôle de soutien, bien que des efforts supplémentaires soient nécessaires pour améliorer la coordination et la collaboration.
En conclusion, Chamrousse s’efforce de s’adapter et de se transformer face au réchauffement climatique en diversifiant ses activités, en réduisant son impact environnemental et en favorisant une gouvernance collaborative pour assurer sa durabilité future.
Bibliographie
Augustin, J-P, et al. « La géographie des sports en France, Paris, Vuibert. », 2008.
Bailly, A. « Pour un développement durable des stations de sports d’hiver. In: Revue de géographie alpine, tome 90, n°4. », 2002.
Baribeau, C, et Royer, C. « L’entretien individuel en recherche qualitative : Usages et modes de présentation dans la Revue des sciences de l’éducation. Revue des sciences de l’éducation, 38(1), 23-45 », 2012.
Bessy, O. « La transition touristique en moyenne montagne. Quelle stratégie de développement pour la station de Cauterets demain ? Sud-Ouest européen, 79-95 », 2021.
Bonnemains, A, Clivaz, C, Franco, C. « Quelle capacité d’adaptation des stations de sports d’hiver intégrées ? Entre rigidité, obsolescence et valorisation des ressources. 11ème Colloque de l’Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (AsTRES) », 2022.
Buin, M. « Les stratégies d’adaptation et les modes de gouvernances des stations de moyenne montagne face au réchauffement climatique : L’exemple des montagnes du Jura à travers les stations des Rousses et de Métabief Mont d’Or. », 2022.
Charrier, D, Jourdan, J, et al. « L’impact social des grands événements sportifs : Réflexions théoriques et méthodologiques à partir de l’Euro 2016. », 2019.
Clivaz, C, et al. « Tourisme d’hiver. Le défi climatique. Lausanne. PPU. Coll. Le Savoir Suisse. », 2015.
Courlet, C. « L’économie territoriale. Presses universitaires de Grenoble. », 2008.
Crozier, M, et Friedberg, E. « Le pouvoir et la règle : Dynamiques de l’action organisée. Paris: Seuil. », 1993.
Di Méo, G. « Une géographie sociale entre représentations et action. Montagnes méditerranéennes et développement territorial. Volume N°23. », 2008.
George, E, Achin, C, François, H, Spandre, P, Morin, S, et al. « Changement climatique et stations de montagne alpines : impacts et stratégies d’adaptation. Sciences Eaux & Territoires », 2019.
Lascoumes, P, et Le Gales, P. « Sociologie de l’action publique. Armand Colin. », 2014.
Marty, C, et al. « How much should we trust snow projections? An evaluation of CMIP5 and CORDEX‐Africa downscaling over the central Andes of Argentina and Chile. Journal of Geophysical Research : Atmospheres 122.5 : 2660-2679. », 2017.
Observatoire national de la montagne. « Les enjeux des changements climatiques en montagne : état des lieux et perspectives pour la gestion des territoires. Rapport final. », 2020.
Solelhac, A, et C Hautbois. « Management et marketing des stations de montagne. Presses Universitaires du Sport. », 2021.
Vlès, V. « Anticiper le changement climatique dans les stations de ski : la science, le déni, l’autorité. Sud-Ouest européen, 51 », 2021.